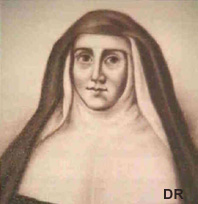Le 4 septembre
1640 (il y a un an que Marie est à Québec), elle écrit
– car c’est une grande épistolière au sens
XVIIe siècle du terme – à l’un de ses parents
: « J’ai reçu votre lettre en ce bout du monde
où l’on est sauvage sinon lorsque les bateaux sont arrivés
que nous reprenons notre langue française. »
Rien ne sera épargné à ces ursulines dans ce
pays où tout – à commencer par la vie quotidienne
– est difficile. Mais elles sont là dans un but –
une mission – bien précis : l’évangélisation
des Indiens. Alors le danger, les froids terribles, les attaques iroquoises,
l’incendie de décembre 1650 qui ravage leur couvent,
les affectent douloureusement, certes, mais elles ne se plaignent
jamais. Et Marie se félicite de la ferveur qui anime le pensionnat
créé pour éduquer les jeunes « néophytes
» :
— Nous y avons baptisé un grand nombre d’hommes
et de femmes et de filles qui faisaient paraître des sentiments
si chrétiens que nos cœurs fondaient de tendresse et de
dévotion.
Et encore, dans une lettre du 29 septembre 1643 : « Une jeune
femme fut tellement transportée dans cette action qu’aussitôt
qu’on lui eut versé sur la tête les eaux sacrées
elle se tourna vers les assistants en s’écriant : «Ah,
c’en est fait, je suis lavée» (…). Il y avait
plus de dix-huit mois qu’elle pressait pour être admise
au nombre des enfants de Dieu (…). Un jeune homme, de ceux que
nous vîmes baptiser, ne voulut jamais partir quoique tous ses
gens le quittassent, qu’il ne fût lavé des eaux
du saint baptême. Je l’interrogeai assez longtemps sur
les mystères de notre sainte religion. J’étais
ravie de voir qu’il avait plus de connaissance de notre sainte
religion que des milliers de chrétiens qui font les savants.
C’est pour cela qu’on le nomma Augustin. »
Et encore, ces Pâques québécoises :
— Comme le grand fleuve de Saint-Laurent a été
cette année tout plein de glace, il a servi de pont à
nos Sauvages et ils y marchaient comme sur une belle plaine. Nous
eûmes toute la satisfaction possible la veille et le matin du
saint jour de Pâques de les voir accourir à perte d’haleine
pour se confesser et communier. Comme nous sommes logées sur
le bord de l’eau, ils aperçurent quelques-unes de nous
et s’écrièrent : « Dites-nous si c’est
aujourd’hui le jour de Pâques, auquel Jésus est
ressuscité ? Avons-nous bien compris notre Massinahigan (c’est
un papier où on leur marque les jours et les lunes) ? »
Oui, dîmes-nous, mais il est tard et vous êtes en danger
de ne point entendre la messe. A ces mots, ils commencèrent
à courir au haut de la montagne et arrivèrent à
l’église où ils eurent encore le temps de faire
leurs dévotions.
Madeleine Foisil (Femmes de caractère au XVIIe siècle)
rappelle : « Il faut une résistance physique et morale
exceptionnelle pour réaliser une vocation religieuse au Canada.
Dans sa volumineuse correspondance, Marie de l’Incarnation nous
en relate les multiples péripéties liées à
la dureté du climat, à la présence des tribus
sauvages combatives et violentes. Mais en une définition claire,
concrète, sans complaisance, elle en précise l’exigence.
En 1644, il y a cinq ans qu’elle est au Canada, elle a une expérience
véritable, elle sait ce dont elle parle. » Témoin
cette lettre à son fils datée du 30 août 1644
:
« La vocation du Canada ne doit point se regarder dans une affection
naturelle non plus que dans un trop grand empressement mais bien dans
une vraie et solide persévérance ; autrement, les sujets
qu’y passeront n’y auront jamais de satisfaction et, ne
trouvant point ce qu’ils attendaient, reprendraient bientôt
le chemin de la France. »
Dans une autre lettre à la supérieure des ursulines
de Saint-Denys, elle trace le portrait « idéal »
des novices qui pourraient être envoyées au Canada :
« Les vocations de cette importance méritent d’être
éprouvées. Les qualités requises sont «tant
de corps que d’esprit». Pour le corps il est nécessaire
qu’elle soit jeune pour pouvoir facilement apprendre les langues
; qu’elle soit forte pour supporter les fatigues de la mission
; qu’elle soit saine et nullement délicate afin de s’accommoder
au vivre qui est fort grossier en ce pays. »
Et aussi que la novice ne songe pas, une fois au Canada, à
un retour possible en France :
« Ce sont deux de nos sœurs qui veulent retourner en France
dans la maison de leur profession. Elles sont là depuis plus
de dix ans. Il y a cinq ans que je combats ce dessein et que je les
exhorte à se rendre fidèles à leur vocation (…).
Il nous aurait néanmoins été beaucoup plus doux
de les voir mourir entre nos bras… que de leur voir faire une
action qui peut tirer à exemple et qui aura des suites peu
avantageuses à la gloire de Dieu » (lettre à son
fils, 2 octobre 1655).
Elle sait de quoi elle parle. N’a-t-elle pas, elle-même,
été tentée de quitter le Canada après
le dramatique incendie du couvent en 1650 ? Mais elle ne sera pas
tentée bien longtemps : « Il nous fallait rebâtir
sur les premiers fondements puisque nos courages n’étaient
point abattus du poids de cette disgrâce, que nos vocations
étaient autant et plus fortes qu’auparavant (…).
On me charge de la conduite et de l’économie de ce bâtiment
où j’ai bien des peines et des fatigues dans les difficultés
qui se rencontrent dans ce pays couvert de neige jusqu’en mai.
»
Un an et demi plus tard, pour la Pentecôte 1652, tout est reconstruit
: « Nous sommes en notre nouveau bâtiment de la veille
de la Pentecôte. Et c’est le jubilé par l’action
de grâce. La paroisse, avec tout le clergé et un grand
concours de peuple, y vint transporter le Très Saint Sacrement
au lieu où nous étions logées. Tout le monde
était dans la joie de nous voir logées où nous
l’étions auparavant. »
Mais il serait injuste de parler de Marie de l’Incarnation sans
évoquer Mme de la Peltrie. Née à Alençon
en 1603, veuve sans enfant, elle vivait en tertiaire de saint François
quand elle eut connaissance de la Relation du père
Lejeune. Ayant eu connaissance des projets de Marie de l’Incarnation,
Mme de la Peltrie, vint à Tours pour la rencontrer. Mme de
la Peltrie et Marie de L’Incarnation montèrent à
Paris et obtinrent de la Compagnie de la Nouvelle-France la promesse
d’un départ en 1639. Anne d’Autriche appela à
Saint-Germain-en-Laye les ursulines et Mme de la Peltrie pour les
assurer, avant leur embarquement, de son approbation et de son concours.
Mme de la Peltrie (née Madeleine de Chauvigny) – qui
consacra toute sa fortune à la mission du Canada – accompagnera
les religieuses en Nouvelle-France. Elle mourra à Québec
en 1674.
Dans le même temps que des ursulines de Tours se préparaient
à partir pour le Canada, chez les hospitalières de Dieppe
d’autres religieuses se préparaient au même voyage.
Les pères jésuites leur avaient demandé d’assurer
le service de l’hôpital que venait de fonder en Nouvelle-France
Mlle de Combalet, nièce de Richelieu, future duchesse d’Auguillon,
lectrice elle aussi de la Relation de 1634. Trois religieuses
furent ainsi désignées pour la mission canadienne.
Le 4 mai 1639, ce furent donc « deux troupes séraphiques
de trois ursulines et de trois hospitalières », comme
le dira le père Leclercq, qui s’embarquaient à
Dieppe. « C’était la première offrande féminine
de la France au Canada, celle de la charité, avec tout ce que
lui ajoutent le sentiment maternel et la grâce », a pu
écrire Bernard de Vaulx.
Alain
Sanders
—
Pour en savoir plus :
• A. Duval, La Vie admirable de sœur Marie de l’Incarnation,
religieuse converse de l’ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel
en France, fondatrice d’iceluy appelée au monde la demoiselle
Acary, Paris, 1922.
• Bernard de Vaulx, Histoire des missions catholiques françaises,
Arthème Fayard, 1951.