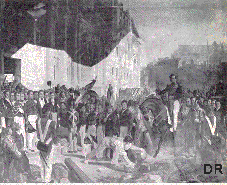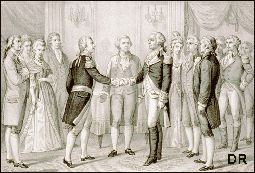|
|
Lafayette, héros de deux nations
|
Metz, 17
août 1755. A la table du comte de Broglie, chevalier des
Ordres du Roi, lieutenant-général de ses armées,
commandant en chef des Trois Evêchés. En son hôtel
de la Haute-Pierre (c’est, aujourd’hui, le palais
de justice de Metz).
Ce soir-là, le comte traite SAR le duc de Gloucester,
frère du roi d’Angleterre George III. A un moment,
une belle dame de la suite de Gloucester déclare :
— J’espère que le gouvernement de SM George
III, notre bien-aimé souverain, aura vite fait de ramener
à la raison ces voyous de Boston qui refusent de payer
des impôts. Et qui maintenant se révoltent ouvertement.
Qu’attend-on pour les pendre ?
Cette belle jeune femme, lady Thorms, continue :
— Il faut les pendre ! Où allons-nous si tous les
va-nu-pieds des colonies se mettent à se révolter
?
Un silence. Et une voix, jeune et ferme qui s’élève
:
— Ces voyous, ces va-nu-pieds, comme vous nommez les Insurgents,
sont des hommes qui luttent pour la liberté. Ils méritent
l’estime des honnêtes gens.
L’auteur
de cette intervention qui fait scandale ? Gilbert de Motier,
marquis de Lafayette, né au château de Chavaniac
en Auvergne. Il a 17 ans et il est marié, depuis quelques
mois, à la fille du duc d’Ayen, de la maison de
Noailles. Il est capitaine et il est, à Metz, sous les
ordres de son cousin et, pour l’occasion, son hôte,
le comte de Broglie.
A ce moment, le duc de Gloucester prend la parole :
— Ce jeune homme n’a pas absolument tort. Si l’on
veut trouver les vrais fauteurs du soulèvement des colons,
ce n’est pas à Boston qu’il faut les chercher.
Mais à Londres. Au palais du Parlement.
Brouhaha. Gloucester continue. Et on passe à autre chose.
Mais, ce soir-là, Lafayette a pris une décision
: il ira se battre aux côtés des Insurgents.
Au matin, il convoque son serviteur, Jean Desalme.
— Prépare mes bagages, nous partons.
— Nous partons ?
— Oui. Pour l’Amérique. On va acheter un
bateau pour y aller.
|
|


|
|
| 

|
|
—
Prépare mes bagages, nous partons.
— Nous partons ?
— Oui. Pour l’Amérique. On va acheter un
bateau pour y aller.
— Un bateau ? Mais ça coûte… Que va
dire Me Nicolas Dufourment ?
Dufourment, ancien secrétaire du père de Lafayette
tué à l’âge de 25 ans à la
bataille de Minden face aux Anglais, est le mentor du jeune
chien fou. Et il administre les biens de Lafayette. Il va falloir
le convaincre. Certes Lafayette est riche. Très riche.
Mais la fortune familiale est déjà bien écornée.
Il n’empêche : Lafayette convainc Dufourment qui
accepte l’achat du bateau à la condition d’être
du voyage. Plus tard, Lafayette rencontre son ami, Charles de
Guéménée qui se dit prêt à
l’accompagner.
Pour concrétiser leur projet, les deux amis regagnent
Paris et s’installent à Versailles où ils
ont leurs habitudes au Cabaret de l’Epée-de-bois.
Un soir, un Anglais, Lord Crawley, pris de boisson, se permet
de critiquer Marie-Antoinette. Sans hésiter, Lafayette
le provoque en duel. Et lui transperce l’épaule.
Une action d’éclat qui lui permet d’être
reçu par le ministre de la Guerre, M. de Maurepas. Lafayette
plaide sa cause et demande au ministre de lui accorder son agrément.
— C’est une folie, dit Maurepas. Je vous la refuse.
De retour
à Metz, Lafayette compte ses « troupes »
: Guéménée, Boismartin, le chevalier de
Chastelluz, une centaine de volontaires. Dont un vieux baroudeur
allemand revenu de toutes les guerres, le baron – ou supposé
tel… – de Kalb.
Un jour, un « Anglais » se présente à
Lafayette. Il se nomme Gibbs, se dit irlandais, affirme détester
les Anglais et se faire fort de trouver un bateau à Bordeaux.
Peu méfiant, Lafayette le charge de la transaction. En
fait, Gibbs est un espion à la solde de lord Crawley.
Qui le charge de « monter » à Versailles
pour tout raconter à l’ambassadeur du roi d’Angleterre.
Quinze jours plus
tard, Gibbs est de retour à Metz. Pour dire qu’il
a trouvé le bateau. Un brick de 200 tonnes, armé
de vingt canons. Son prix ? Une petite fortune : 112 mille livres.
« Trop cher, dit Dufourment. Pas question de payer. »
|
|
|
On
suggère alors à Lafayette un marchand d’armes de
Paris : Caron de Beaumarchais. Ce dernier, qui ne fait pas que l’auteur
de pièces de théâtre, œuvre sous le pseudonyme
de Rodrigue Hortalez et arme déjà les Insurgents.
Il accepte de prêter à Lafayette les 112 mille livres.
Si l’opinion publique est anti-anglaise, la France officielle
ne peut prendre le risque de fâcher l’Angleterre. Une lettre
de cachet condamne Lafayette à être emprisonné à
la Bastille. Histoire de le calmer. Il se cache alors dans Paris et,
clandestin dans la ville, il rencontre Benjamin Franklin dans sa résidence
de Passy. Franklin le nomme alors major-général dans l’armée
des rebelles.
Fou de joie, Lafayette quitte Paris et rejoint Bordeaux par des chemins
de traverse. Il s’installe à l’Auberge de la
Lame d’acier où il est bientôt rejoint
par une quarantaine de volontaires : Chastelluz, Boismartin, Simat,
La Colombe.
Recontacté par Gibbs, Lafayette paie le prix du voilier au nom
prémonitoire, La Victoire, mais à l’aspect
peu recommandable : c’est un rafiot. On embarque pourtant et on
se prépare à appareiller. Trop tard ! Une barque bloque
le navire. A son bord, un huissier, Me Chovin, et Me Dufourment. Et
des archers du roi.
— Nous venons saisir le bateau, dit Me Chovin.
— Et à quel titre ? La Victoire est au nom de
mon ami Boismartin.
La Victoire appareille et met à la voile sur Pasajez,
petit port espagnol. De là, Lafayette dépêche Jean
Desalme au duc d’Ayen, son beau-père, avec une lettre lui
demandant de transmettre à Maurepas une « autorisation
de voyager ». Sans plus de précisions. Deux semaines après,
Desalme revient. Sans l’autorisation.
— Il faut partir, décide Lafayette qui sait qu’il
peut être arrêté à tout moment.
Et l’on part. Pour un voyage long et pénible : La Victoire
se traîne. Après 52 jours de mer, c’est l’Amérique.
Les voyageurs débarquent près de Georgetown où
ils sont reçus par le notable de la ville, le major Benjamin
Hüger. Qui leur conseille d’aller à Philadelphie et
de rejoindre George Washington via Charlestown.
A Philadelphie, personne ne les attend. Et personne ne veut les recevoir.
Après maintes protestations, Lafayette obtient d’être
reçu. Les lettres de recommandation de Franklin ? Ses interlocuteurs
n’en ont rien à faire. Les grades d’officiers ? Nuls
et non avenus. Des soldes ? Il n’y a pas un sou.
|
|
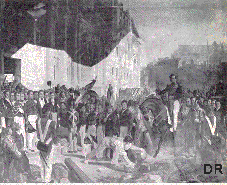
|
|
Lafayette
se fâche, discute, explique. On lui concède le grade
de major-général. Mais sans solde. Et on n’accepte
d’engager que deux de ses compagnons : Simat et La Colombe.
— Et les autres ?
— Qu’ils rentrent en France !
Le lendemain, Lafayette est reçu par Washington. Le courant
passe entre les deux hommes. Washington l’emmène voir
ses troupes. Dix mille hommes. En guenilles. Affamés.
Un officier, gêné par ce spectacle, dit au jeune Français
:
— Nous nous sentons embarrassés de nous montrer ainsi
à un officier qui vient des troupes françaises.
|
|
—
C’est pour apprendre et non pour enseigner que je suis
ici, répond Lafayette qui, du même coup, conquiert
les cœurs.
A Brandywine, c’est le baptême du feu pour Lafayette.
Il est de tous les assauts. Il y gagne une blessure : un méchant
coup de baïonnette. Après de longues semaines de
convalescence Washington lui confie le commandement de 4 000
hommes à Albany et le charge d’aller reprendre
le Canada aux Anglais ! Ces 4 000 soldats sont en haillons,
ils sont squelettiques et tétanisés par le froid.
Lafayette leur achète des vêtements, les nourrit,
restaure la discipline.
Lafayette,
qui échappe de peu à un kidnapping préparé
par les Anglais, est de tous les combats. A la bataille de Montmouth,
il œuvre en tant que second de Washington. |
|
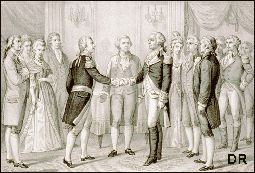 |
|
En
France, la situation a évolué. Et Louis XVI, qui
a définitivement choisi son camp, envoie aux Insurgents
une flotte commandée par l’amiral d’Estaing.
Pour concrétiser cette alliance, Lafayette embarque sur
L’Alliance, justement et, après trois
semaines de mer, arrive en France. A Versailles, il est reçu
et fêté par le roi et la reine. Condamné
à huit jours d’arrêts pour être parti
sans autorisation, il est aussitôt nommé maistre
de camp de l’armée française.
Après une année passée en France, Lafayette
revient en Amérique avec cinq mille hommes commandés
par Rochambeau. Sous les vivats, les Français débarquent
à Boston le 28 avril 1780. Mais il faut déjà
repartir. Direction Yorktown où les Insurgents assiègent
les troupes du général Cornwallis.
Cornwallis n’est pas un inconnu pour Lafayette. C’est
lui qui commandait à la bataille de Minden où
le père du jeune héros a été tué.
Le 19 octobre 1781, la ville de Yorktown, Virginie, tombe entre
les mains de Washington. Un célèbre tableau du
musée national du château de Versailles représente
l’état-major franco-américain lors du siège
de la ville. Au centre, Washington. A sa gauche, Lafayette.
A sa droite, Rochambeau.
La campagne, qui mettait fin à la guerre d’indépendance
américaine, nécessita une totale coopération
franco-américaine. Coopération sur terre, où
il s’agissait de savoir si l’on se battrait pour
New York ou plus au sud, en Virginie. Coopération terre-mer
avec l’appui de la flotte française.
En juillet 1781, Rochambeau et ses hommes avaient rejoint Washington
au nord de New York. Mais l’amiral de Grasse insista –
et obtint gain de cause – pour intervenir en Virginie.
Non seulement De Grasse intercepta victorieusement la flotte
anglaise venue en renfort mais, remontant la baie de Chesapeake
jusqu’à Baltimore, il transborda les 9 000 hommes
de Washington et les 7 800 hommes de Rochambeau jusqu’à
Yorktown.
De retour en France, Lafayette est devenu la coqueluche de Paris.
Il est reçu à l’Hôtel de Ville, à
l’Opéra, à Versailles. Il se déguise
en Peau-Rouge, il porte des anneaux dans le nez, il enseigne
la danse du scalp ! Il est nommé maréchal de camp
et il est fait chevalier de Saint-Louis. Et l’on répète
avec admiration le nom de ses enfants : son fils, George-Washington
; sa fille, Virginie. |
|

Il
reviendra pour un long séjour en Amérique où
Washington le recevra comme un fils dans sa belle propriété
de Mount-Vernon. Mais il faut rentrer. Et retrouver un pays
où l’orage commence de gronder. En 1787, il est
désigné par la noblesse pour représenter
la sénéchaussée d’Auvergne. Le
reste ? Eh bien, le reste c’est une autre histoire de
l’Histoire. Et elle est nettement moins héroïque…
Alain Sanders
|
|
| Retour |