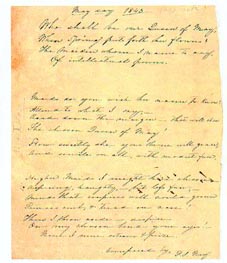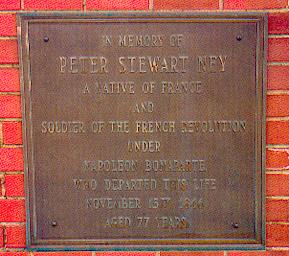|
|
Peter
Stuart Ney, instituteur d’une petite ville de Caroline du Sud
en 1819, était-il le maréchal Ney
?
|

Michel Ney,
duc d'Eichingen, prince de la Moscova, maréchal de l'Empire
en 1804.
(Meynier
Charles, 1768-1832) - DR -
|
|
A
Brownsville, Caroline du Sud, Etats-Unis d’Amérique,
Peter Stuart Ney avait été engagé comme instituteur,
en 1819, pour remplacer l’instituteur précédent
parti à la retraite. Très contents de lui avoir
trouvé un remplaçant, les parents d’élèves
eurent bientôt l’occasion de se féliciter du
nouveau maître. Intelligent, vêtu à la militaire,
ponctuel, sourcilleux sur la discipline, il avait ainsi décliné
ses qualités lors de son embauche :
— Je viens de consacrer trois années à une
étude approfondie du grec, du latin et des mathématiques.
Et cela avait suffi à imposer le respect. D’autant
que, dans sa classe, Peter Stuart Ney n’admet pas le moindre
écart. « Un jour, raconta plus tard l’un de
ses élèves, je restai délibérément
– dans un accès de rébellion – les talons
écartés malgré le commandement de garde
à vous ! Il vint alors vers moi et me marcha sur le
pied avec une telle force que je n’oubliai jamais la leçon.
»
Sévère ? Oui. Mais juste. Un autre jour, ayant noté
que des melons d’eau avaient été volés,
sans doute par des élèves gourmands, il essaya de
découvrir les coupables. L’un des « suspects
» interrogés lui ayant déclaré : «
Je connais ceux qui ont fait ça, mais je ne peux pas les
trahir », il félicitera le garçon : «
Tu as raison. J’espère que tous imiteront ton silence.
»
Evoquant le souvenir de ce Ney d’outre-Atlantique dans un
ancien numéro d’Historia, en 1960, Bernard
Boringe souligne d’autres traits du bonhomme : « Toujours
complaisant, il apprenait aux enfants à se tenir à
cheval (lui-même montait magnifiquement) ; il aidait ses
voisins à rédiger leurs lettres ; il leur donnait
des conseils pour soigner les chevaux et même pour construire
des ponts ou des écluses. Avide de lecture, il s’intéressait
aux journaux, il écrivait des articles ou des poèmes
en vers. Il savait dessiner et peindre à l’aquarelle
et, surtout, il adorait la musique.
|
Il possédait une flûte, et les passants restaient longtemps
sous les fenêtres de sa maison à écouter les airs
mélancoliques dans lesquels il semblait se complaire. »
Aux curieux qui lui demandaient : « D’où venez-vous
? Avez-vous de la famille ? », il répondait, mystérieux
à souhait : « L’obscurité est ma gloire. »
Ou : « Je ne suis pas inscrit sur le registre commun des hommes.
» Parlant grec, latin, hébreu, français, écossais,
un peu l’allemand et le russe, Peter Stuart Ney avait dû
être, de l’avis général, soldat. Ne maniait-il
pas, à l’occasion, sa canne comme un sabre ? Ne l’avait-on
pas vu, un jour, soutenir un combat d’entraînement avec
un professeur d’escrime réputé et avoir raison de
lui au point que le professeur dira aux élèves admiratifs
:
— Vous avez là un maître, vous n’avez pas besoin
de moi.
Un autre de ses écoliers témoignera quelques années
plus tard :
— C’était un aigle, un lion, un tigre du Bengale.
De son regard se dégageait un magnétisme auquel nul ne
pouvait rester insensible. Quand il posait les yeux sur vous, vous aviez
le sentiment qu’il pénétrait jusque aux tréfonds
de votre âme, et on ne pouvait que l’aimer ou le craindre.
|
|
En
1821, un incident déclencha de nouvelles interrogations
sur cet homme exemplaire qui avait fini par faire partie du paysage
de Brownsville. Un des élèves ayant apporté
en classe un journal, Peter Stuart Ney s’en empara et commença
de le lire. Pour s’effondrer de son estrade quelques minutes
plus tard ! Les élèves le ranimèrent et un
docteur, appelé à la rescousse, le conduisit jusqu’à
sa chambre.
Le lendemain, l’instituteur ne s’étant pas
présenté à l’école, l’un
de ses voisins, le colonel Rogers, se présenta chez lui.
Malgré des coups répétés contre la
porte, personne ne lui répondit. Aussi décida-t-il
de forcer la serrure. Pour trouver Peter Stuart Ney gisant dans
son sang, un couteau planté dans la poitrine !
Le docteur, de nouveau appelé à l’aide, et
pour du sérieux cette fois, réussira à arrêter
l’hémorragie. Sorti de son coma et sommé de
s’expliquer sur cet acte insensé, le blessé
dira, en sanglotant :
— Oh… Napoléon est mort. C’est mon dernier
espoir qui s’en va…
Et l’on comprit qu’il avait lu, dans le journal de
la veille, cette nouvelle qui l’avait bouleversé
: la mort de l’Empereur à Sainte-Hélène.
Mais en quoi cela le concernait-il ? Et au point de se suicider
! Il consentira à s’en expliquer :
— Vous connaissez le nom de Ney, maréchal de France
? On a dit qu’il avait été fusillé
en France le 7 décembre 1815. C’est un mensonge…
— Mais quelle preuve avez-vous de cela, s’inquiétera
le colonel Rogers.
— La preuve ? La preuve, c’est que le maréchal
Ney c’est moi !
|
|
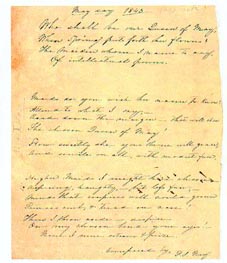
Acrostiche
pour Martha Hampton par
Peter Stewart Ney, 1843.
(Rowan
Library Davidson college, Caroline du Nord) - DR - |
«
Bribes par bribes, nous dit Bernard Boringe, le blessé raconta
son histoire. Ses auditeurs l’écoutaient, médusés.
Les grandes étapes du procès du maréchal, dont
ils avaient tant entendu parler quatre ans plus tôt, leur revinrent
peu à peu en mémoire. Nul n’ignorait que le meilleur
des soldats de Napoléon était passé, après
l’abdication de Fontainebleau, au service de Louis XVIII ; qu’au
moment du retour de l’île d’Elbe, et malgré
sa promesse au roi de ramener Bonaparte «dans une cage de fer»,
il était tombé dans les bras de l’Empereur à
Lons-le-Saunier ; enfin, qu’après Waterloo, il avait figuré
en tête de la liste de proscription pour crime de trahison. Découvert
dans un château du Cantal par la police royale, il avait été
jugé à Paris par la Chambre des pairs. La condamnation
à mort du «brave des braves» avait causé beaucoup
d’émotion, aussi bien en France qu’à l’étranger.
Dans les milieux du faubourg Saint-Germain, la haine contre les serviteurs
du Corse avait alors atteint son paroxysme : assoiffées de vengeance,
les dames royalistes se réjouissaient de voir couler le sang
des traîtres. Implorée par la maréchale Ney, la
duchesse d’Angoulême s’était bornée
à répondre qu’elle ne s’occupait pas de politique.
Louis XVIII, débordé par ses propres partisans, ne pouvait
songer à faire grâce au vieux soldat. »
|
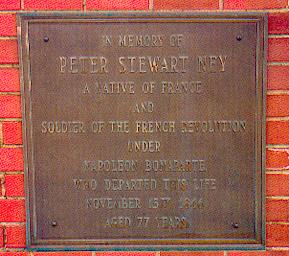
Plaque
apposée sur le mausolée de protection de la sépulture
de Peter Stewart Ney, cimetière de Third Creek, Caroline
du Nord
(Rowan
Library Davidson college) - DR -
|
|
D’où
la décision des amis de Ney, prince de la Moskowa, de préparer
son évasion. Parmi eux le lieutenant Selves (1) qui tenta
– en vain – de percer le plancher de sa cellule. Et
aussi trois Anglais qui, plus tard, réussirent à
exfiltrer La Valette de Paris, mais échouèrent dans
leur tentative en faveur de Ney.
Le 7 décembre 1815, un fiacre entouré d’une
forte escorte de soldats, quitte le palais du Luxembourg à
9 heures du matin. A l’intérieur du fiacre, le maréchal
Ney que l’on conduit sur le lieu de son supplice, à
l’Observatoire (alors qu’à l’ordinaire
les exécutions avaient lieu place de Grenelle).
A quelques mètres du point de destination, le fiacre s’arrête.
Ney et deux gendarmes en descendent. Un prêtre s’avance
vers le prisonnier qui s’agenouille, reçoit la bénédiction
et, avisant le peloton d’exécution, s’écrie
:
— Je proteste devant le Ciel et les hommes que le jugement
qui me condamne est inique. J’en appelle à l’Europe
et à la postérité.
On propose de lui bander les yeux. Il refuse et va s’appuyer
contre le mur qu’on lui a désigné. Et puis
:
— Faites votre devoir. C’est là qu’il
faut frapper, ne me manquez pas… Mon honneur…
|
Il
n’a pas le temps d’en dire plus : une salve et il s’écroule
frappé à mort. Le corps sera emporté vers l’hospice
voisin de la Maternité. Il y restera deux jours puis sera transféré,
dans le plus grand secret, au cimetière du Père-Lachaise.
— Ça, c’est la version officielle, explique le Ney
de Caroline du Sud à ses auditeurs interloqués. En fait,
j’ai été sauvé par l’intervention de
la loge maçonnique de l’Ancienne Fraternité qui
a agi avec l’accord d’un illustre franc-maçon, le
duc de Wellington. Wellington était le vrai maître de Paris
depuis Waterloo et l’occupation en France qui en a résulté.
Je sais bien qu’on dit que Wellington avait officiellement refusé
d’intervenir pour moi en disant qu’il ne voulait pas s’occuper
de la politique du gouvernement français. S’il l’a
dit, ce n’était qu’une façade.
— Que s’est-il
alors passé ? demandent les auditeurs désormais passionnés.
— Le soir de ma condamnation, Wellington est allé voir
Louis XVIII pour obtenir ma grâce. Mais, sous l’influence
du comte d’Artois, le roi a refusé. Wellington lui a alors
dit : « Vous oubliez que je commande les armées qui vous
ont mis sur le trône ! »
Ainsi, grâce à l’illustre Anglais, le peloton d’exécution
ne fut-il composé que d’anciens soldats de la Grande Armée
à qui il fut commandé de « viser haut ». Il
était entendu que je me jetterais aussitôt sur le sol.
— Mais
le sang ?
— On m’avait fait parvenir dans ma prison une fiole contenant
un liquide couleur sang. En me laissant tomber, je l’ai brisée.
Et j’ai attendu. Au bout d’un quart d’heure, on m’a
transporté à l’hôpital de la Maternité.
Là, on a mis un cadavre à ma place et je me suis enfui.
Le soir même, je partais pour Bordeaux avec le Corse Pascal Luciani,
apparenté à l’Empereur, et le général
Lefevbre-Desnouettes. Une quinzaine de jours plus tard, j’avais
des billets pour l’Amérique sur le City of Philadelphia.
Et nous partîmes, Luciani, Lefebvre-Desnouettes et moi. Et nous
débarquâmes à Philadelphie.
— Comment avez-vous vécu ?
— J’ai étudié le grec, l’anglais, le
latin, l’hébreu pendant trois ans. Et j’ai choisi
l’enseignement. Mais maintenant que Napoléon est mort,
tout est fini, tout est fini…
— Mais pourquoi avez-vous gardé ce nom qui vous dénonçait
?
— Parce que c’est le mien. J’y ai adjoint deux noms
: le prénom de mon père, Pierre [Peter], et le nom de
ma mère, Stuart, qui était d’origine écossaise.
Je vous demande de garder mon secret, mes amis. Si les Bourbons me savaient
vivant, ils enverraient un assassin pour se débarrasser de moi.
Tous jurèrent. Mais Peter Stuart Ney, qui s’était
mis à boire beaucoup, ne sut tenir sa langue, faisant état
à tout propos désormais, et notamment devant ses élèves,
de sa véritable identité. Et il se mit à lire tout
ce qui concernait l’Empereur : Napoléon et ses maréchaux
de Headley, La Vie de Napoléon de Walter Scott, Napoélon
en exil d’O’Meara.
|
Son
histoire ayant fait le tour de la Caroline du Sud, il partit
s’installer, toujours comme instituteur, à Mocksville,
en Caroline du Nord. Ayant appris que Louis-Philippe avait succédé
aux Bourbons, il placera alors ses espoirs dans le duc de Reichstadt
:
— Napoléon II montera sur le trône et je
rentrerai en France, car je suis le maréchal Ney.
En 1832, l’Aiglon meurt et Peter Stuart Ney se laisse
aller de nouveau au désespoir :
— Le jeune Napoléon est mort. Avec lui s’évanouit
pour moi tout espoir de rentrer en France, de revoir ma femme,
mes enfants, mes amis…
|
|
 |
A
l’occasion, il voyage. Dans l’Etat d’Indiana, à
Knightown, il tombe dans les bras d’un pasteur protestant qui
se trouve être le colonel polonais Lehmanowski, ancien de la Grande
Armée. Un autre jour, il confie à un ami :
— Ma femme m’a écrit de rentrer. Elle me dit qu’on
m’a pardonné. Mais le vieux Ney n’ira pas. Il y a
un piège là-dessous. Si j’y allais jamais, je m’arrangerais
pour arriver à la nuit tombée et repartir avant l’aurore.
En 1846, alors âgé de 77 ans et très malade, il
est soigné par le docteur Locke qui lui avoue ne plus pouvoir
rien faire pour lui :
— Vous avez vécu dans le mystère. Vous allez mourir.
Dites-nous qui vous êtes vraiment…
— Je ne veux pas mourir le mensonge aux lèvres : je suis
Michel Ney, maréchal de France.
Le même soir, il s’éteint en disant : « Bessières
est mort, la Vieille Garde est battue ! Maintenant que je meure ! »
Enterré au cimetière de Third Creek, sa tombe porte ces
mots : « A la mémoire de Peter Stuart Ney, natif de
France et soldat de la Révolution française sous Napoléon
Bonaparte. Il a quitté cette vie le 15 novembre 1846, âgé
de 77 ans. »
Relevant un certain nombre d’erreurs concernant le véritable
Ney dans les récits et les souvenirs du Ney d’outre-Atlantique,
Bernard Boringe écrit :
« Toutes ces erreurs seraient invraisemblables si elles étaient
tombées de la plume du «brave des braves». Mais le
plus extraordinaire est sans doute la façon dont Peter Stuart
Ney raconte la pseudo-fusillade de l’Observatoire. Comment imaginer
qu’un tel secret ait été gardé par les soldats
d’exécution ? Comment personne n’aurait-il vu que
ces hommes tiraient par-dessus la tête du condamné ? Comment
supposer qu’aucun des curieux ayant défilé devant
le corps du maréchal, à l’hospice de la Maternité,
ne se soit aperçu qu’il y avait eu substitution du cadavre
? Un dernier argument s’impose. Après la révolution
de juillet, Louis-Philippe se montra favorable aux Bonapartistes et
se plut à rendre leurs pensions aux vieux serviteurs de Napoléon.
Le président du Conseil, Jacques Laffitte, maria sa fille au
jeune prince de la Moskowa, fils du «brave des braves».
Certains députés demandèrent même qu’on
transportât au Panthéon la dépouille du maréchal
Ney. Pourquoi celui-ci, s’il avait alors été en
Amérique, n’aurait-il pas traversé l’Océan
pour revoir sa famille et recevoir à Paris les hommages de tous
les partisans de Napoléon ? »
Reste que le Ney d’outre-Atlantique était à coup
sûr un ancien soldat. Qui avait connu les guerres de l’Empire.
Et qui avait reçu de graves blessures – notamment à
la tête – au combat. Expliquent-elles une éventuelle
mythomanie accentuée par un goût exagéré
du whiskey ? Il n’empêche qu’en 1946, les habitants
du Third Creek firent une grande cérémonie pour le centième
anniversaire de sa mort. Et que le 4 février 1909 mourut à
Saltillo, Indiana, un centenaire nommé E.M.C. Neyman, docteur
de son état et qui disait descendre du maréchal Ney :
— Je suis né en France, à Paris, le 2 février
1808. Ma mère se nommait Aglaé Auguié et j’étais
le troisième de quatre enfants. Je me rappelle encore Waterloo,
j’avais quatre ans, qui détruisit notre foyer.
Il expliquait encore qu’une fois installé en Amérique,
son père l’avait envoyé à Baltimore faire
ses études de médecine. A cette date, Peter Stuart Ney
était bien maître d’école dans un village
des Carolines. Le vieillard de Saltillo parlait, du reste, rarement
de ses origines de peur de nuire au reste de sa famille restée
en France. Nul ne mit en doute sa parole. Après sa mort, il eut
droit à une pierre tombale sur laquelle étaient gravés
ses mots : « E.M.C.
Neyman. Originaire de France. Fils du maréchal Ney. »
Le docteur Neyman eut une descendance. Son fils, épicier dans
une petite ville du Texas, eut deux filles. Il donna à l’une
d’elles le prénom d’Aglaé, prénom qui,
faut-il le rappeler, était celui de la princesse de la Moskowa…
Alain Sanders
(1) Sous le nom d’Osman Pacha, il servit plus tard dans l’armée
de Mehmet Ali.
|
| Retour |
|